| |
| ¤
Historique du quartier de BANGE |
|
En 1910 la municipalité d'ISSOIRE décide
d'avoir son régiment. Elle procède à l'achat
d'un ensemble de parcelles de terrains d'une superficie totale
de 52 hectares limité au nord par un chemin de terre devenu
depuis l'avenue de BANGE, au sud par le ruisseau de PEIX, à
l'est par la route de Saint-Germain-Lembron, à l'ouest
par le chemin des Quinze.
Par convention, le 16 avril 1910, elle accorde
de plus au ministère de la Guerre, une subvention de 1500000
F de l'époque à titre de fonds de concours.
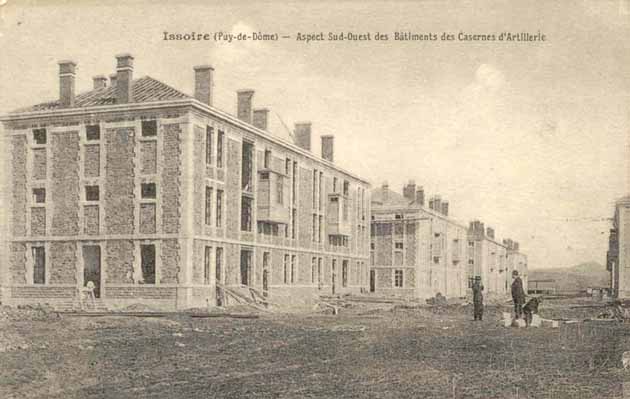
Pour réaliser ces opérations, elle avait effectué
un emprunt à long terme.
Les travaux ont commencé avant la déclaration de
guerre et en 1914 ils étaient assez avancés pour
permettre de procéder aux opérations de mobilisation
des recrues de la région.
Toutefois, ce n'est qu'en 1920 que les bâtiments
furent terminés et ISSOIRE put recevoir son premier régiment:
Le 113e régiment d'artillerie.
Il s'agissait évidemment d'un régiment hippomobile.
Le casernement couvrant 17 hectares entourés d'un sévère
mur d'enceinte comportait donc du nord au sud et d'est en ouest
le long de l'avenue de Bange :
- le logement du casernier,
- un bâtiment du « type troupe» destiné
au service du matériel,
- la cantine,
- le bâtiment PC dont le rez-de-chaussée était
réservé à la bibliothèque de garnison,
au service général ainsi qu'au poste de police qui
commandait la « porte d'honneur ».

Puis dans le prolongement de la place d'armes:
- un bâtiment troupe à l'est et l'infirmerie des
hommes à l'ouest.
- En arrière une première ligne de quatre bâtiments
troupe puis, parallèlement, une deuxième ligne de
trois autres bâtiments troupe complétée par
deux cuisines et une C.D.O.(commission des ordinaires, stockage
des vivres). La capacité théorique d'hébergement
de chacun des 8 bâtiments troupe était de l'ordre
d'une batterie.
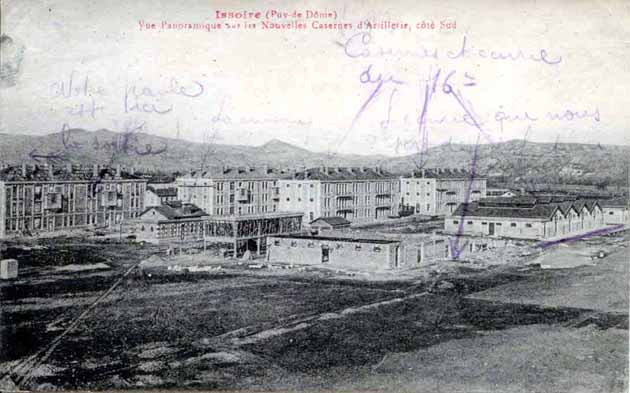
Puis on trouvait la ligne des écuries puis celle des abreuvoirs.
Enfin, le long du mur d'enceinte sud:
- dans le coin est: le domaine réservé aux soins
des chevaux, aux maîtres ouvriers (bottier, tailleur, sellier),
et à des magasins.
On y trouvait en particulier : le bureau du vétérinaire,
l'infirmerie, le pédiluve, l'antre du maréchal avec
sa forge et tout son matériel.
- le manège près de la « porte à fumier»
en réalité un portail qui donnait aussi accès
au « terrain de manœuvre ».
- toute la partie « W » constituait le « parc»
: au nord trois ou quatre maisons d'habitation, ailleurs les remises
à canons, chariots, caissons, et les soutes à munitions.
Sur 35 hectares le « terrain de manœuvre» était
entouré d'une piste cavalière et couvert d'obstacles
variés: buttes, talus, fossés, abattis. Tous les
moyens de procéder dans d'excellentes conditions au dressage
de chevaux et cavaliers, et de conduire l'instruction de l'artilleur:
« L’école de pièce».
La
plupart des cadres logeaient à proximité du quartier:
dans la cité des «Pradets» annexée après
1945 par les cadres de CEGEDUR, et la cité
« BLANC» constituée de petits blocs de 12 appartements
chacun, située à l'emplacement des HLM qui ont conservé
le même nom.
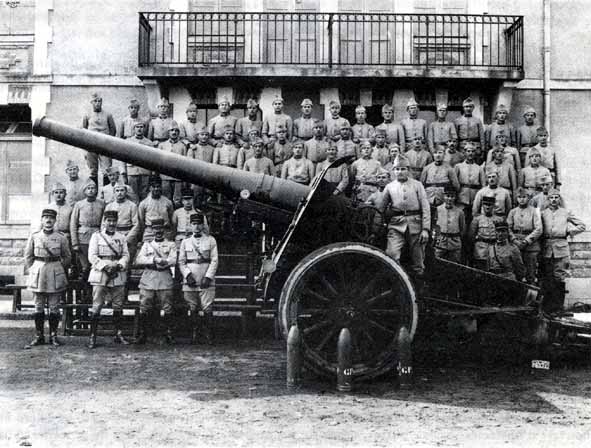
Le 16e régiment d'artillerie et le 36e qui
en était dérivé furent vraiment les régiments
d'ISSOIRE, et nombreuses sont les recrues de la région qui
effectuaient leur service militaire «aux casernes», comme
on disait alors et comme on le dit encore.
Pour procéder à une mobilisation que l'on sentait proche,
on avait construit une vingtaine de baraques sans style de part et
d'autre de la place d'armes.
En 1940 après l'armistice, les cavaliers remplacèrent
les artilleurs: le 8e régiment de dragons,
ne pouvant regagner sa garnison traditionnelle de LUNEVILLE, devint
auvergnat jusqu'à sa dissolution officielle en novembre
1942, lorsque les Allemands envahirent la «zone
libre», mais devenu clandestin il opéra dans les Monts
d'Auvergne avant de rejoindre la 1ére armée, son étendard
ayant été conservé et caché au château
de PARENTIGNAT.
Alors les occupants tinrent à leur tour garnison à ISSOIRE
jusqu'à ce que le revers des armes les en déloge. Il
s'agissait semble-t-il d'une unité d'instruction qui travaillait
au profit des divisions du front «Est». Il reste une marque
de leur passage: le bassin à poissons rouges: ils l'avaient
creusé pour constituer une réserve d'eau destinée
à lutter contre d'éventuels incendies.
A
la libération, un centre d'organisation et d'instruction de
cavalerie y séjourna quelques semaines. Puis ce fut une longue
période de vide pendant laquelle les bâtiments se délabrèrent,
et la végétation envahit quartier et terrain de manœuvre:
des troupeaux y pacageaient, des chasseurs y tiraient le garenne.
Enfin, la création du centre mobilisateur 36
le sortit de l'abandon vers 1956, tandis qu'en 1958
le centre d'entraînement des moniteurs de la jeunesse d'Algérie
(CEMJA) lui redonna vie.
Pour abriter des promotions de 600 élèves encadrées
par 80 officiers dont 60 sous-lieutenants de réserve, et une
vingtaine de sous-officiers d'active, on débroussailla, on
rénova, on transforma. Ainsi le manège devint gymnase,
une écurie devint cinéma, la cantine agrandie et aménagée
devint un foyer de style oriental.
On construisit un bâtiment de douches près du PC, des
salles à manger claires et accueillantes autour d'une des cuisines,
elles-mêmes rénovées et dotées de matériels
modernes.
Le goudron apparut sur la piste passant devant le P.C. La place d'armes
nettement délimitée, soigneusement entretenue, fut le
théâtre de nombreuses cérémonies officielles
parmi lesquelles les baptêmes de promotion en nocturne, à
la lueur des flambeaux, ne manquaient pas de solennité. On
y accédait par la «voie romaine» qui existe encore.
C'est à cette époque qu'apparurent les premières
pelouses, les premiers rosiers, et la première piscine.
Le terrain de manœuvre aplani se transforma en stade.
En 1962, le CEMJA changea de mission tandis qu'il
devenait CEMJ; il recevait alors des jeunes recrues françaises
destinées, après un stage de quatre mois, à devenir
par moitié animateurs culturels ou aides-moniteurs d'éducation
physique dans les unités de l'Armée.
Le premier bâtiment «cadres» connu sous le nom de
CILOF date de cette époque (1960).
En juillet 1963, le quartier de Bange était
choisi pour accueillir l'Ecole des apprentis techniciens de l'armée
de terre.
|
| ¤
Historique de l'Ecole |
|
Dès la fin des événements d'Algérie, le
général LE PULLOCH, alors chef d'état-major de
l'Armée de terre, prend la décision de créer
pour l'Armée de terre une école de formation de techniciens,
homologue des écoles dont la marine et l'aviation s'étaient
dotées depuis longtemps.
L'instruction provisoire sur l'Ecole des apprentis techniciens de
l'armée de terre date du 14 mai 1963, mais
déjà une commission avait été créée
avec mission de rechercher un casernement susceptible de l'accueillir
à bref délai.
Le choix se porta vers Pâques 1963 sur le quartier
de Bange à ISSOIRE, au cœur de l'Auvergne. Une équipe
composée des futurs commandant de l'Ecole, commandant en second
et directeur de l'instruction, s'installa à la caserne Lourcines
à PARIS. En liaison directe avec la direction des armes et
de l'instruction (D.T.A.I.), elle étudia avec la plus grande
diligence tous les problèmes de conception, d'organisation,
de fonctionnement, d'infrastructure qui leur étaient posés:
le général LE PULLOCH était catégorique:
la première rentrée scolaire aurait lieu en octobre
1963.
Dès le mois de juin, les murs nord et sud
des écuries étaient abattus et remplacés par
des vitrages; elles devenaient des ateliers. En juillet
des personnels affectés à l'Ecole rejoignaient leurs
postes, les matériels arrivaient. Comme il n'y avait pas de
logements (ou si peu) pour les familles ni suffisamment de chambres
individuelles, les sous-officiers couchaient en chambres de vingt:
les adjudants-chefs anciens retrouvaient leur jeunesse...
En cette période de vacances, sous un soleil radieux, manches
retroussées, sans distinction de grades, tout le monde s'affairait
à installer sa « maison» : matériel automobile,
lourdes machines outils, appareils de mesure, appareils radio, habillement,
couchage, ameublement, etc. ; tandis qu'au PC les cerveaux préparaient
la rentrée.
Et le premier dimanche d'octobre, arrivaient au milieu
d'un vaste chantier, les quelques 250 premiers élèves
(une demi-promotion pour engrener le système...).
L'accueil était chaleureux. Chacun s'évertuait à
donner confiance aux parents et aux enfants. Mais quel vide à
la chaîne d'habillement. L'intendance n'avait pas suivi. On
ne pouvait distribuer que ce que l'on avait: le paquetage était
allégé au maximum. Et c'est ainsi que pendant deux semaines,
les élèves pionniers n'ont eu pour tout vêtement
qu'un survêtement de sport.
Les salles de cours étaient installées dans les baraques.
En hiver, elles étaient chauffées et souvent enfumées
par des poêles à mazout.
Le logement des cadres devint possible en octobre dans des conditions
souvent précaires grâce à la construction de la
première tranche de la cité d'urgence: pompeusement
baptisée « cité du château» (en raison
de la proximité du château de PEIX) et aussi du recensement
de tout ce qui était habitable dans un rayon de 15 à
20 km.
Ainsi démarra dans l'enthousiasme général une
première année scolaire dont les résultats semblaient
bien hypothétiques.
Les jeunes lauréats du concours d'admission devaient signer,
pour être admis à l'Ecole, une promesse d'engagement
de cinq ans à l'issue de la scolarité, c'est-à-dire
après le premier cycle de formation qui les conduisait à
l'examen du certificat d'aptitude professionnel dans les spécialités
de mécanicien auto, électricien auto ou électronicien.
Ils signèrent tous et à l'issue du contrat de 5 ans,
ils rengagèrent à 80 %. A ce jour, l'Ecole a formé
32 promotions.
La rentrée de la deuxième année scolaire, début
octobre 1964, réserva moins de surprises.
Les jeunes étaient accueillis par leurs anciens et abstraction
faite des nombreux chantiers encore en cours, l'Ecole commençait
à prendre tournure.
Le 26 février 1965, l'Ecole reçut son
drapeau des mains du ministre des Armées, en présence
du général chef d'état-major de l'Armée
de terre. C'est à cette époque que furent terminées
les premières constructions importantes: le bloc alimentation,
l'actuel bâtiment de l'état-major, trois bâtiments
de troupe dont celui de la compagnie école qui abrite aussi
plusieurs bureaux des services administratifs, l'atelier de l'instruction
de spécialité radio (l'actuel IMT électronique),
le mess officiers - sous-officiers.
En 1966, on inaugura le bâtiment des études
(S1), les ateliers des IMT AEB et électromécanique,
les salles spécialisées de sport, les douches du stade
et le chauffage central.
Le goudronnage de la plus grande partie des allées date aussi
de cette époque.
Le décret n° 66284 du 28 avril 1966 s'inspirant
de l'expérience de ces trois premières années
de recherches créa l'Ecole d'Enseignement Technique
de l'Armée de Terre dont la mission était mieux
définie:
« L'Ecole a pour objet d'assurer le recrutement de personnels
techniciens de l'Armée de terre et de donner aux jeunes gens
qui y sont admis en qualité d'élèves, une formation
technique, militaire et morale les préparant à leur
rôle de sous-officiers techniciens et leur permettant d'accéder
aux différents grades ».

De même la situation administrative des élèves
devenait plus nette. Ils devaient signer, trois mois après
leur arrivée à l'Ecole un contrat prenant effet de la
date de leur incorporation et d'une durée égale à
celle de la scolarité (2 ans de préparation au CAP),
augmentée de cinq ans.
La première promotion alla donc en 1965-66 à CLERMONT-FERRAND effectuer son année de spécialisation
sur matériel militaire et préparer le certificat interarmes
(CIA).
Les deux promotions suivantes effectuèrent en troisième
année, par demi-promotion, leur spécialisation sur matériels
militaires à ISSOIRE et allèrent préparer le
CIA au Centre d'instruction d'infanterie de VERDUN.
En 1967, la mise en service du bloc loisirs (cinéma
- foyer) mit un terme aux travaux de la première génération,
auxquels pour être complet il convient d'ajouter la construction
des cités cadres sur la partie sud-est du stade. En même
temps, les baraques, mission accomplie, étaient démolies
et la place d'armes agrandie devenait la « Place rouge».
Pourtant les moyens étaient encore insuffisants pour mener
à son terme l'instruction des futurs sous-officiers techniciens.
1967 fut aussi marquée par la création de
l'annexe de Tulle où l'on forma les élèves dans
les spécialités de l'électromécanique
et de la mécanique générale.
En même temps, l'Ecole suivant l'évolution de l'Education
nationale adoptait les brevets d'études professionnelles.
Ainsi, en 1967, dès sa création, TULLE entreprit la
préparation au BEP d'électrotechnique option électromécanique
(5e promotion).
En 1968, toujours à TULLE, le CAP de mécanique
générale fut remplacé par le BEP de mécanicien
monteur (6e promotion).
A ISSOIRE, la même année apparaît
le BEP d'électronique et en 1971 celui de
l'automobile (technique et service) (9éme promotion). Pour
l'application des programmes de cette spécialité, l'Ecole
est d'ailleurs désignée comme établissement pilote
à l'échelon national.
Enfin, le besoin de comptables devenant urgent, TULLE se voit confier
la préparation du BEP de comptabilité mécanographe
en 1974.
Auparavant, le nombre des électriciens auto étant devenu
très supérieur aux besoins, cette spécialité
avait été abandonnée en 1968
avec la sortie de la 4e promotion.
Le passage des CAP aux BEP entraîna le changement de niveau
du concours: initialement basé sur les programmes de la classe
de 4e, il s'éleva à ceux de la classe de troisième,
avec toutefois une période transitoire pendant laquelle les
élèves destinés aux CAP passaient un concours
du niveau de la 4e, tandis que les futurs candidats aux BEP devaient
affronter un concours du niveau de 3e.
De la 4e promotion à la 7e incluse, par demi-promotion,
l'instruction militaire conduisant au CIA puis au CM1 était
dispensée à l'ENSOA de SAINT-MAIXENT.
A partir de la 8e promotion, l'instruction militaire
et l'instruction technique de troisième année furent
conduites entièrement à ISSOIRE.
Le rassemblement du 3e bataillon en 1972 nécessita
en plus d'un apport important de cadres militaires, la construction
d'un bâtiment d'enseignement militaire, d'un stand de tir à
200 m, d'une piscine chauffée, d'une piste d'instruction de
conduite automobile, de deux gymnases et la recherche de terrains
d'exercices (TREMOULENE, CEYSSAT, BOURG-LASTIC, LA COURTINE).
Mais ces élèves, bien que vivant pendant trois ans dans
une ambiance militaire, manquaient d'ouverture sur l'extérieur
et se trouvaient quelque peu désorientés quand, études
terminées, ils rejoignaient leurs corps d'affectation. Alors
le commandement prescrivit à leur intention un stage d'une
semaine au sein des grandes unités en manœuvre.
Le 1er septembre 1977, l'Ecole devint «
ECOLE NATIONALE TECHNIQUE DES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE ».
Sa vocation était ainsi clairement exprimée;c'était
aussi la reconnaissance de son aptitude à former des sous-officiers
possédant des connaissances techniques satisfaisantes et capables
d'assimiler rapidement des techniques nouvelles.
Depuis cette date, elle n'a cessé de poursuivre son évolution
pour améliorer encore la qualité de ses élèves
dans tous les domaines: formation morale et militaire plus approfondies,
revalorisation des CT1, débuts de l'enseignement' de l'informatique
et de la préparation du baccalauréat de technicien.
Parallèlement, sont mis en place les moyens et les structures
adaptés aux buts poursuivis.
A la rentrée de 1983, les 1er et 2e Bataillons
sont regroupés en un Groupement des Jeunes, placé sous
les ordres d'un Officier supérieur.
La même année, le 3e Bataillon devient le Bataillon.
En juillet 1984, l'annexe de TULLE est dissoute,
les spécialités « Armement Petit Calibre »
et « Technique de Gestion » sont supprimées, le
cours BEP et baccalauréat option « Electromécanique
» s'installe à ISSOIRE.
En septembre
1985, le 9, les élèves de
la 23° promotion font leur entrée
dans l'école.
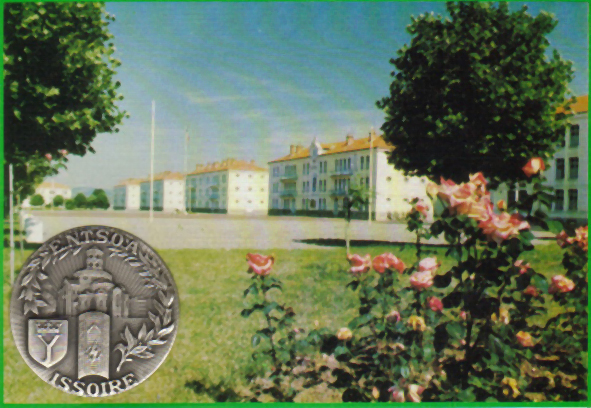
|
| ¤
Les Traditions de l'E.N.T.S.O.A. |
|
Les
« Traditions» sont un ensemble de souvenirs, de gloires
ou de coutumes propres, soit à l'Armée française
toute entière, soit à une arme, un service, un régiment
ou une école, que chacun se doit de respecter et de perpétuer
pour manifester sa fierté d'en faire partie, y puiser des exemples
et renforcer les liens qui l'unissent aux autres membres de la communauté.
LA
PROMOTION
I.
ORGANISATION
Au Groupement de Jeunes, chaque unité possède un président
de Compagnie secondé par des présidents de sections.
Le Bataillon est représenté par un bureau de promotion,
composé d'élèves dont la mission est de perpétuer
et de développer les Traditions de l'Ecole d'ISSOIRE et d'organiser
les cérémonies marquant les différentes étapes
de la scolarité.
Ce bureau est constitué de 6 élèves:
- le président de promotion,
- le trésorier,
- le secrétaire,
- les trois présidents de compagnies.
Dans chaque compagnie, les sections sont représentées
par les présidents de sections.
II.
LES ETAPES DE LA VIE D'UNE PROMOTION
Au
cours de son séjour à l'Ecole, chaque promotion voit
sa vie marquée, sous l'angle des traditions, par une série
d'étapes.
21.
Première année:
- accueil par la promotion précédente,
- au cours du 2e trimestre, présentation au Drapeau de l'Ecole,
- participation des élèves de première année
à la fête de l'Ecole.
22.
Deuxième année:
- accueil des élèves de première année,
- en fin d'année, cérémonie dc remise des képis
marquant le passage de la vie scolaire à l'état militaire
et professionnel,

- participation à la fête de l'Ecole,
- formation de la garde du Drapeau de l'Ecole à compter du
jour de la remise des galons aux élèves de 3e année.
23.
Bataillon de troisième année:
Premier trimestre: désignation du bureau de promotion.
Deuxième trimestre: choix du parrain et du nom de promotion
- choix des armes;
- réalisation de l'insigne et de l'album de promotion.
Fin d'année:
- choix des garnisons,
- fête de l'Ecole avec cérémonie de remise du
galon de sergent,
- défilé du 14 juillet à PARIS ou dans une grande
ville.
24.
Après la sortie de l'Ecole
Participation individuelle ou en délégation des anciens élèves aux rassemblements ayant lieu au quatier De Bange..
DEVISE
DE L'ECOLE
Grande
Ecole de formation, l'ECOLE NATIONALE TECHNIQUE DES SOUS-OFFICIERS
D'ACTIVE avait tout naturellement trouvé sa place à côté
de l'ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE de SAINT-MAIXENT.
Ecole originale, seule à mener de front pendant trois années,
une formation militaire et technique aussi poussée, s'adressant
à de très jeunes gens, elle se présentait
comme étant particulièrement apte à satisfaire
les besoins de l'Armée de terre de l'an 2000. Besoins en personnels
capables de mettre en œuvre des techniques très évoluées
tout en conservant un esprit et un comportement rigoureusement militaires.
Le sous-officier de demain correspondait donc bien à ce soldat
technicien formé à ISSOIRE. C'est pourquoi il est apparu
nécessaire, en son temps, de synthétiser et de symboliser cet esprit
par deux mots essentiels qui étaient inscrits au-dessus de l'insigne de l'Ecole
qui dominait la place d'armes:
EXEMPLE
ET RIGUEUR
EXEMPLE:
parce qu'au combat, le chef est bien celui qui, au moment du danger,
passe toujours devant. Exemple de compétence aussi pour dominer
la technique et commander aux techniciens.
RIGUEUR: car, quand des vies d'hommes sont en jeu,
il ne peut y avoir de place pour l'à-peu-près et le
laisser-faire. Rigueur aussi dans le domaine technique qui ne tolère
plus le manque de fiabilité.
Ainsi nous devons être fiers de ces valeurs qui nous ont été transmises lors de notre passage à notre Ecole et nous en montrer dignes.
|
| ¤
Le Sous-Officier de l'Armée de Terre |
|
Sous
l'ancien régime, le bas-officier, issu du rang, constitue la
cheville ouvrière d'une armée alimentée en hommes
qui, bien souvent, ne sont pas les meilleurs de la population.
Jusqu'au 12e siècle, il n'y a que des caporaux et des sergents,
auxquels viennent s'ajouter, au XVIIIe siècle, les sergents-majors,
les sergents fourriers et les adjudants.
Ces bas-officiers ne passent qu'exceptionnellement officiers, en récompense
d'un fait d'armes parvenu à la connaissance du roi, qui leur
achète alors une compagnie.
En 1789, les sous-officiers, pour la grande majorité, deviennent
officiers. Certains deviennent généraux comme HOCHE
et finissent même maréchaux d'Empire: MASSENA, BERNADOTTE.
Sous la restauration, la loi GOUVION SAINT-CYR leur ouvre, en 1818,
un tiers de vacances d'officiers dans les corps. La loi SOULT, en
1832, leur ouvre dans la pratique, deux tiers des vacances d'officiers
dans l'infanterie et la cavalerie.
Les hécatombes de 1914-1915 pousseront aux places d'officiers
un bon nombre de sous-officiers d'avant-guerre et l'épreuve
du feu permettra, d'autre part, de tirer de la troupe des sous-officiers
remarquables.
Le 30 mars 1928, le corps des sous-officiers se voit doté pour
la première fois d'un statut.
En 1940, l'Armée française disposait d'un corps de sous-officiers
de qualité qui remplit dans la plupart des cas sa mission avec
honneur et bravoure. Pendant la campagne de 1943 à 1945, ils
firent preuve de qualités exceptionnelles grâce à
leur moral élevé, la sélection de leur recrutement
et leur compétence.
Après 1945, la guerre terminée, se furent les campagnes
d'Indochine et d'Algérie au cours desquelles les sous-officiers
de l'Armée française assumèrent souvent des responsabilités
importantes dans des conditions difficiles dûes au climat et
à l'isolement.
Enfin, les années 70 virent la parution de plusieurs textes
dont, le 30 octobre 1975,le nouveau statut du corps des sous-officiers
de carrière et la création du corps des majors, à
compter du 1er janvier 1976.
ORIGINE
DU GALON DE SERGENT
Le
mot chevron désigne aujourd'hui le galon que porte un SERGENT.
Un chevron, en menuiserie, est une pièce de bois équarrie
qui soutient les lattes sur lesquelles on pose les tuiles d'un toit.
Dans l'Armée, un chevron était un galon en V renversé,
porté sur la manche de l'uniforme, qui indiquait l'ancienneté
de service, les blessures, les campagnes, etc. D'où l'expression:
“un militaire chevronné” qui s'appliquait à
un soldat expérimenté ayant de longs services.
ROLE
DU SOUS-OFFICIER
Dans
l'Armée française, la place du corps des sous-officiers
est capitale. Chargés
de fonctions précises et essentielles, ils sont les collaborateurs
irremplaçables des officiers.
L'énumération des cinq aspects que revêt l'activité
militaire du sous-officier suffit à montrer l'importance de
son rôle.
1.
AU COMBAT :
le rôle du sous-officier au combat est suffisamment défini
dans les règlements : il assiste l'officier et décentralise
son action. Il convient toutefois de souligner que les adjudants-chefs
et les adjudants sont prévus dans les TED pour tenir des emplois
de chefs de section et de chefs d'atelier.
2.
A L'INSTRUCTION:
suivant son ancienneté et sa compétence, le sous-officier
est moniteur ou instructeur. Responsable d'un groupe, d'une équipe
ou d'une classe, il a pour rôle d'expliquer les gestes à
exécuter et d'amener les hommes à en comprendre l'utilité.
La phrase «faites comme moi» définit la qualité
d'exécution à laquelle on doit parvenir. Il doit donc
être un modèle et c'est par l'exemple qu'il donne et
sa connaissance des hommes qu'il contribue pour une part importante
à leur éducation.
3.
DANS LE SERVICE INTERIEUR:
là encore, le rôle
du sous-officier est essentiel, puisqu'il porte
la responsabilité du bon fonctionnement du service intérieur.
Il veille à la propreté et à l'entretien des
locaux, du matériel, des effets, de l'armement. Chargé
de la discipline, il fait respecter les horaires, contrôle la
tenue, etc. Il assure aussi le service: sous-officier de semaine,
chef de poste, sous-officier et officier de permanence.
4.
DANS L'ADMINISTRATION:
les sous-officiers sont la cheville
ouvrière de toute l'administration jusqu'à
l'échelon compagnie: fourrier, comptable, vaguemestre. A l'échelon
au dessus, ils remplissent très souvent des fonctions d'officiers:
trésorier, matériel, service auto, habillement, ordinaire,
etc. Les qualités du sous-officier sont donc le dévouement
à l'unité, à son chef direct, le sens de la discipline,
la rigueur de la présentation, la compétence technique,
la ponctualité, la patience, la persévérance,
la résistance physique, le bon sens et le sens pratique de
la vie militaire, la générosité et la simplicité.
5.
EN DEHORS DU SERVICE:
hors service, le sous-officier se doit également d'être
exemplaire dans sa tenue, son comportement, le choix de ses relations,
car à travers lui c'est l'Armée toute entière
qui est jugée. Enfin, en fonction de ses capacités et
de ses goûts personnels, il s'efforce d'animer les temps libres
et les loisirs de ses hommes.
Haut
de page
|